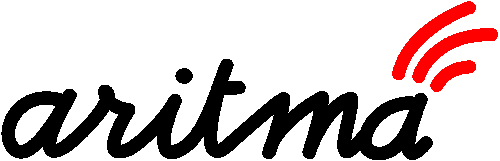Votre panier est actuellement vide !
Table ronde Jeu éducatif – Paris est Ludique 2015
Voici ma transcription de Table Ronde Jeu Educatif – Paris Est Ludique 2015.
A propos, je vous rappelle le lien vers l’enregistrement audio de la table ronde sur Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=fUBoA57ZFNg
J’espère que cela permettra des échanges intéressants sur le rôle du jeu dans l’éducation. Donc n’hésitez pas à commenter !
———————
[Gabriel Ehman]
Bienvenue au festival Paris est Ludique pour cette table ronde sur l’utilisation des jeux de société comme moyen éducatif.
Je me présente. Gabriel Ehman, je suis responsable des formations BAFA, BFD, Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur ou de directeur.
Je vais animer cette table ronde.
Ce que je vous propose c’est de faire un tour de table pour que chacun puisse se présenter.
Voici ma transcription de Table Ronde Jeu Educatif – Paris Est Ludique 2015.
J’espère que cela permettra des échanges intéressants sur le rôle du jeu dans l’éducation. Donc n’hésitez pas à commenter !
———————
[Gabriel Ehman]
Bienvenue au festival Paris est Ludique pour cette table ronde sur l’utilisation des jeux de société comme moyen éducatif.
Je me présente. Gabriel Ehman, je suis responsable des formations BAFA,
BFD, Brevet d’aptitudes aux fonctions d’animateur ou de directeur.
Je vais animer cette table ronde.
Ce que je vous propose c’est de faire un tour de table pour que chacun puisse se présenter.
[François Guély]
Je suis éditeur d’une collection de jeux éducatifs pour l’école primaire, qui s’appelle DidaCool.
Elle est coéditée avec Cocktail Games.
Je m’intéresse à ce sujet depuis pas mal de temps.
J’ai fait de la recherche sur les processus d’apprentissage en intelligence artificielle.
Je me suis toujours intéressé aux processus cognitifs et d’apprentissage.
Pour moi le jeu est important en tant que moyen d’apprendre.
[Phil Muller]
Je suis depuis 25 ans dans le jeu de société.
Je travaille en centre de loisir, en centres de vacances.
J’ai l’habitude du terrain, de voir des enfants qui découvrent pour la première fois certains jeux modernes.
Je fais un peu le passeur pour les règles, pour créer des liens entre eux.
C’est hyper important qu’il y ait quelqu’un qui explique les règles aux enfants et aux adultes.
J’ai aussi une association qui d’appelle la magie des jeux qui permet
d’aborder les jeux de société à travers la magie car je suis également
magicien.
[Bruno Faidutti]
Je suis un auteur de jeux à succès depuis pas mal de temps.
Mes jeux ne sont pas du tout éducatifs. Je fais même tout pour qu’ils ne le soient pas.
Je vais être l’avocat du diable ici car je suis plutôt hostile au jeu éducatif.
Je suis également enseignant. J’ai une formation d’économiste et historien, et professeur d’économie en Lycée.
Mais s’il m’arrive de jouer avec mes élèves, il est clair que c’est un
jeu et que n’est jamais destiné à apprendre quoi que ce soit.
[Fadila Taieb]
Je suis adjointe au maire du XIIème. Je m’occupe de la jeunesse et des sports.
Sous l’ancienne mandature je m’occupais de l’école et de tout ce qui
est périscolaire. L’éducatif, l’éducation à travers le culturel, le
ludique, le sportif.
Grandir par le jeu ça me parait être une réalité inhérente à la nature humaine.
[Louis Sorlat]
Créateur des jeux de société Weelingua.
Egalement professeur et conférencier sur le rôle du jeu dans l’apprentissage.
Contrairement à Bruno, je défends la théorie que nous pouvons apprendre
énormément de choses comme le vocabulaire, la grammaire, l’orthographe.
Le jeu permet justement en activant certaines zones du cerveau de
transférer l’information de la mémoire à court terme à la mémoire à long
terme pour avoir un apprentissage réel.
[Gabriel Ehman]
Je dirige beaucoup de centres de vacances et on se sert du jeu.
On ne dit pas aux enfants qu’on va s’éduquer, mais tout en mettant en
place des jeux on a des projets d’animation avec des objectifs à la clé.
[François Guély]
La collection est à but pédagogique et destinée aux enseignants et conçue pour les classes.
Il y a toujours un objectif identifié lié au programme scolaire, une
problématique scolaire précise comme le vocabulaire, la grammaire, le
calcul mental, à quelle classe ça se pratique et toujours un manuel
pédagogique associé.
[Louis Sorlat]
On est basé à Bruxelles.
On a commencé depuis un an et demi.
Le ministère de la culture nous a introduit dans beaucoup d’écoles en
Wallonie, et on permet aussi aux enfants flamants d’apprendre le
Français et aux francophones d’apprendre le néerlandais.
Pouvoir jouer et apprendre des notions permet d’entrainer l’étudiant dans une dynamique positive.
Quand on joue on est émotionnellement impliqué. On a envie d’apprendre,
de partager, d’autres personnes ont envie de la compétition.
Quand ce processus émotionnel est engagé, vous favorisez l’acquisition du vocabulaire, de la grammaire, etc…
Un exemple : est-ce que vous savez ce que vous faisiez le 27 Mars dernier ?
Est-ce que vous savez ce que vous faisiez le 11 Septembre 2001 dernier ?
[Bruno Faidutti]
Quel rapport avec le jeu?
[Louis Sorlat]
Quand la mémoire émotionnelle est impliquée, ça permet de mémoriser inconsciemment sans s’en rendre compte.
On peut aussi faire en chansons, la chanson également touche l’émotionnel.
[Gabriel Ehman]
Donc l’apport majeur du jeu serait d’apprendre sans s’en rendre compte ?
[Louis Sorlat]
Exactement
[Bruno Faidutti]
Je pense tout simplement que ça ne marche pas.
Dire que les jeunes vont apprendre sans s’en rendre compte.
On est un peu dans la même démarche… les enfants il faut leur faire avaler une pilule, on va la cacher dans un yaourt.
ca marche un petit moment, très vite ça ne marche plus.
Vous dites aux élèves – on va faire un jeu.
Ils savent très bien qu’ils ne sont pas vraiment en train de travailler.
Ils savent très bien qu’un jeu c’est quelque chose qui n’a aucun impact sur le réel et qui ne sert à rien.
A partir du moment on est sur quelque chose qui sert à quelque chose on est plus dans le jeu.
Je pense que vous vous trompez quand vous dites qu’on va leur apprendre sans qu’ils s’en rendent compte.
Ils se rendent très bien compte qu’on les prend pour des cons, pour des
gens qui ne vont pas se rendent pas compte qu’on va essayer de leur
apprendre quelque chose.
Le résultat c’est qu’on dévalorise à la
fois l’enseignant et l’enseignement par ce qu’ils disent quand même ils
nous prennent pour des imbéciles.
Et on dévalorise aussi le jeu qui parait comme un outil plutôt que comme une fin en soi.
On ne va pas faire avaler la pilule comme ça bêtement aux gamins.
J’ai une expérience de tente ans comme enseignant, et si j’en retire
une chose c’est que prendre les élèves pour des cons c’est une mauvaise
stratégie.
Utiliser le jeu pour faire passer des connaissances sans que les élèves en soient conscients c’est très exactement ça.
[François Guély]
On ne cache jamais aux élèves que le jeu a un contenu éducatif en particulier quand c’est à l’école.
Ils savent bien qu’à l’école on est là pour ça.
En aucun cas on va leur faire croire qu’on n’est pas en train de leur apprendre des choses.
Mais le jeu a plusieurs rôles.
Un rôle, ça peut être de dédramatiser.
Quand on est face à des notions nouvelles, on peut avoir peur de la complexité.
C’est très fréquent que des enfants prennent du retard et ne le rattrapent pas parce qu’ils sont bloqués.
Ils sont bloqués car ils se font une montagne de choses qui ne sont pas si compliquées que ça en fait.
Par le jeu on dédramatise et on leur fait comprendre que au fond ce n’est pas si compliqué.
Ils se mettent dans une démarche plus positive, et où ils vont avoir un engagement actif, et se mettre à apprendre tout seul.
C’est un point important car loin de prendre l’enfant pour un idiot, au contraire on lui montre qu’il n’est pas idiot.
On lui montre que ce n’est pas si compliqué que ça, et qu’il est aussi intelligent que les autres et capable de progresser.
[Phil Muller]
Mon expérience elle est magnifique.
Un enfant qui arrive pour la première fois dans un lieu qu’il ne
connait pas, le jeu va lui permettre de s’intégrer, de prendre confiance
en lui, d’avoir une bonne image de lui car il est écouté, il est
valorisé.
Souvent on oublie d’écouter les enfants.
Je me rends compte que des fois ils me disent des choses merveilleuses.
A travers le jeu il y a un apprentissage incroyable.
Si on n’a pas de plaisir en tant qu’adulte on peu rarement en
transmettre aux enfants, et les enfants sont beaucoup dans le plaisir.
[Fadila Taieb]
Pourquoi est-ce qu’on serait obligé de mentir aux enfants ?
Ce n’est pas parce qu’on fait un jeu qu’on ne peut pas leur dire que
l’objectif c’est aussi d’apprendre et de comprendre quelque chose.
[Bruno Faidutti]
Parce que ce n’est pas un jeu
Si on leur dit que le but c’est d’apprendre on leur dit que ce n’est pas un jeu.
[Fadila Taieb]
Dans le jeu on peut aussi leur faire comprendre qu’il y a des choses à apprendre.
Par le jeu on n’est pas obligé d’apprendre uniquement le Français, les
maths, mais aussi la gestion de groupe, stratégie, etc. qui peuvent
amener énormément de choses et développer chez l’enfant des notions pas
forcément développées ailleurs à l’école.
Vous êtes en train de dire qu’il y a l’éducation qui appartient à l’école et le jeu qui est en dehors de l’école.
Mais l’éducation n’appartient pas qu’à l’école. Elle appartient aux
parents, aux éducateurs, à tout individu qui encadre un enfant.
Le jeu est inhérent au développement de l’enfant et de l’individu de manière générale.
Mais oui, on grandit à travers le jeu. A travers le jeu, l’enfant
imagine, projette, se construit des scénarii, quelque chose dans la vie
qui touche à tout ce qui nous entoure.
Il joue avec les objets, les
images, la matière, avec le son, avec la voix, avec son corps, avec les
mots, avec les espaces, avec lui-même, avec les adultes, donc il se
confronte aux autres.
Il confronte sa liberté à celle des autres.
Dans les règles du jeu il y a aussi la limite des règles, dans lesquelles tout individu doit s’intégrer.
C’est aussi la sociabilité le jeu.
Le jeu et l’apprentissage sont bien caractérisés dans le domaine du
développement, et dans les neurosciences c’est très bien démontré.
Le sport est souvent très encadré, organisé. Le sport par le jeu par
exemple comme en Grande Bretagne, c’est du sport mais quand c’est sans
compétition c’est aussi de l’éducation.
Faire une partie de foot
avec des copains c’est aussi des règles de foot, des règles avec les
autres, on peut jouer même sans des matchs et un tournoi.
Les élus imaginent des heures où on fasse du jeu pour du jeu qui peut être du sport, ou du sport pour le sport.
Voilà en quoi les mairies peuvent intervenir.
Il y a eu une polémique incroyable quand il y a eu la réforme sur les rythmes scolaires.
L’idée c’était de faire entrer du culturel, de l’animation, du jeu, du
sport dans les écoles, c’est-à-dire de diversifier l’éducation auprès
des enfants.
La diversification de l’éducation c’est ça le maitre mot, et ça passe par le jeu, par le sport, par le culturel.
Les mairies ont un rôle à jouer pour ouvrir les établissements
scolaires pour que rentrent d’autres acteurs de l’éducation autour des
enfants.
[Bruno Faidutti]
Il y a il me semble une confusion entre le jeu et le jouet.
Le jeu c’est justement quand on fait un match, quand on fait un sport.
Au sport on essaie de gagner.
C’est ça le jeu. Le jeu c’est un système ou on essaie de gagner, où on essaie de voir qui est le meilleur.
A partir du moment où on renonce à ça et où on fait n’importe quoi d’une certaine manière.
Je pense que l’éducation a besoin d’improvisation, de mélange, de réflexion.
On est dans un système qui est infiniment trop cadré.
Dans la réforme du collège je suis plutôt favorable notamment dans tout ce que ça encourage dans le mélange des disciplines.
Tout ça ça va à l’inverse du jeu, dans un système qui sort des règles.
Le jeu c’est imposer des règles.
On a un système de notes en France qui est le pire que ce qu’il y a nulle part ailleurs au monde je crois.
Les notes, c’est du jeu, c’est exactement ça. C’est dire on va voir qui a le meilleur score.
J’ai envie de dire on fait trop jouer les gamins, pas assez les adultes.
On utilise le jeu pour faire entrer les gamins dans un système de compétition.
Autant le jouer sans règle, je pense qu’il faut l’encourager, autant les systèmes trop structurés c’est à éviter.
Le jeu c’est quelque chose de très sérieux. Quand on joue on ne s’amuse pas.
Je pense qu’on doit apprendre en s’amusant, en bricolant, en faisant
des blagues, et rigolant avec les élèves, en se mettant à leur écoute,
et ça c’est le contraire du jeu.
[Personne du Public]
Trois petits exemples qui contredisent tout ça
On anime des soirées enquêtes dans les lycées
Le jeu de rôle a été plus efficace pour apprendre aux étudiants des
choses sur une exposition que la présentation faite par le guide de
l’exposition.
Ils ont eux-mêmes cherché des solutions, entraidé,
constitué des équipes avec leaders, ce qui amené une compréhension
incroyable de l’exposition.
Ca a marché sans les mettre en compétition puisque c’était un système d’équipe.
Un autre exemple frappant.
Un jeu pédagogique multimédia – étude de thèse sur l’apprentissage des mathématiques très probant.
Techniquement, ça marche et ça peut se mesurer.
[François Guély]
Dans le domaine éducatif la majorité des jeux qui marchent sont
coopératifs où ne présentent pas une forte compétition dans le jeu.
Pourquoi ? Parce qu’à l’école, ce qu’on veut c’est faire progresser les plus faibles.
Les plus forts progressent par eux même sans problème.
Pour faire progresser les plus faibles, il faut qu’ils soient motivés
par le jeu et donc que ce ne soit pas toujours les plus forts qui
gagnent.
C’est le problème de base à éviter quand on fait un jeu éducatif pour l’école.
Le jeu doit être coopératif ou avoir une part de hasard importante, ce
qui fait que les plus faibles gagnent comme les plus forts.
Tout le monde progresse, ça ne doit surtout pas être un jeu de compétition.
Mais ça reste un jeu. Ce n’est pas parce qu’il n’y a pas de compétition que ça n’est pas un jeu.
[Phil Muller]
Sur le côté implication de l’adulte, Monsieur Faidutti, j’ai été dans
une soirée jeux avec vous et je m’en souviendrai toute ma vie car
j’étais dans un espace, un univers magique, merveilleux.
C’est hyper important que les adultes s’impliquent dans le jeu des enfants.
L’adulte propose, et les enfants eux aussi ont plein de propositions à faire.
Ceux qui parfois ne parlent pas peuvent aussi être meneurs.
On partage par le jeu, j’ai découvert des jeux grâce à des enfants qui m’ont expliqué les règles.
Le jeu c’est pour tout le monde, c’est universel.
On rencontre des gens, on parle, on est heureux. Les apprentissages viennent au niveau et au rythme des enfants.
[Fadila Taieb]
La participation des adultes est très très importante.
Quand dans les centres de loisirs parisiens on fait des projets sur
toute une année, l’idée c’est effectivement de les faire travailler par
le jeu sur des thématiques.
Il y a eu une année où on les a fait travailler sur Darwin.
Ca s’est terminé dans tous les parcs parisiens avec des jeux de fléchage et des parcours à faire.
C’est le travail de toute une année sur une thématique sur quelque
chose de ludique, léger, de sympathique, participatif, et où il n’y a
pas de différences entre celui qui est fragile et ceux qui ont des
facilités.
Qu’est-ce que c’est bien de passer par ce biais là pour
découvrir l’évolution du vivant à travers du jeu… c’est différent de
l’école mais c’est aussi des choses qu’on ne voit pas forcément à la
maison.
[Louis Sorlat]
L’être humain est un grand joueur à la base.
A votre avis, quel est le premier jeu interactif auquel l’être humain joue ?
…
Le jeu du coucou
L’enfant acquiert le sens de l’humour aussi par le jeu.
C’est important d’avoir des jeux où les adultes ne s’ennuient pas, et
l’enfant apprend que les adultes peuvent faire des erreurs.
[Bruno Faidutti]
Les mathématiques sont déjà un univers de règles, où on ne peut pas mettre en cause le système dans lequel on joue.
Dans les sciences humaines, le jeu est plutôt quelque chose de dangereux.
En particulier dans l’économie, le jeu amène à fonctionner sur des
modèles, sur un cadre rigide, à ne jamais discuter les règles.
Par définition vous ne pouvez plus discuter les règles.
Un des problèmes qu’on a dans l’enseignement est qu’on ne discute pas
suffisamment des règles, on ne discute pas suffisamment du pourquoi de
ce que l’on enseigne.
Le jeu suscite l’imagination, mais c’est une
imagination stratégique encadrée par les règles, ce n’est pas une
imagination critique.
Je pense que dans les maths, à moins d’être à très haut niveau, on n’a pas besoin d’imagination critique.
Dans l’histoire, l’économie ou la sociologie, on en a besoin très tôt, et le jeu est plutôt dangereux.
[Personne du Public]
Pour les adultes on utilise surtout la gamification pour sensibiliser à des problèmes, mais on reste sur le superficiel.
Quand on attaque le sujet en profondeur, on ne joue plus véritablement.
Pour ce qui concerne les entreprises, la gamification permet de faire
avaler des sujets pas superbement intéressants tels que la qualité, la
gestion de difficultés ou problèmes, la gestion des risques
On n’est pas dans de l’apprentissage mais plutôt dans de la communication.
[Fadila Taieb]
Les règles sont indispensables dans la vie.
On a du souci avec ceux qui n’intègrent pas les règles.
De ce point de vue là, si le jeu permet d’apprendre que les règles
permettent de vivre avec les autres, on ne peut pas être contre.
Par contre, quand tu dis que le règle à l’école ça veut dire interdiction de poser des questions, de se tromper, d’interroger.
Ce n’est pas le problème de la règle, mais de l’éducation nationale à
la Française. On transmet le savoir du haut vers le bas, ce n’est pas
suffisamment interactif.
La question se pose depuis des années, et
si on regarde des modèles d’Europe du Nord, on apprend à regarder
différemment l’enseigner, à échanger autrement, à découvrir le savoir
différemment.
C’est plus la problématique de l’éducation nationale telle qu’elle est aujourd’hui que celle de la règle.
[Personne du Public]
Je suis directeur de centre de loisir.
Si un enfant commence à jouer, il est forcément dans l’éducatif.
On a l’habitude de mettre des jeux de société en grand jeu, cela fonctionne.
Les enfants participent tout de suite, même s’ils ne connaissent pas le jeu de société en lui-même, ils adhèrent d’emblée.
[Gabriel Ehman]
Dans les séjours de vacances, les accueils de mineurs, le jeu est
beaucoup utilisé sur des temps informels pour faciliter la relation
entre l’adulte et l’enfant.
L’enfant se représente l’adulte comme
disant ce qu’il faut faire et ne pas faire, et sur des temps informels,
on joue ensemble à un jeu où il y a la règle, elle est la même pour tout
le monde et on ne voit plus l’animateur comme l’adulte référent mais
comme un joueur.
En ça est-ce que ce n’est pas une manière de faciliter l’éducation, où celui qui enseigne n’est plus perçu de la même façon.
[Fadila Taieb]
J’en suis convaincu.
Je pense que c’est une adhésion de l’enfant ou du jeune.
On partage la règle, on joue avec à se dire comment on la respecte à travers tel ou tel parcours.
De ce fait vous l’aidez à se dire qu’il participe à la construction de la règle ou du jeu.
J’ai envie de dire que le jeu est presque un synonyme de jeu.
Ce sont des petits points où chacun trouve sa place.
Quand on adhère, c’est beaucoup plus facile.
L’autoritarisme, on le sait, ça ne marche pas.
C’est parce que l’enfant n’est pas un idiot, c’est une personne très tôt.
Quand on le regarde comme une personne très tôt, en particulier par le partage des règles, on donne confiance à l’adulte.
On connait beaucoup de jeunes qui vous disent je vais à l’école avec le mal de ventre.
Une personne me racontait que tous les matins elle essayait de fuir,
ou avait des nausées permanentes, car elle avait ces difficultés de
l’autorité, de ne pas trouver sa place.
Faire venir d’autres
éducateurs que vous êtes – la bienveillance par cette éducation là est
bienveillante et amène l’adhésion de l’enfant.
[Personne du Public]
C’est bon, mais à l’extérieur de l’école.
Je vais être enseignant au niveau Lycée en histoire en Belgique, et j’ai été sensibilisé la dessus.
Le jeu de société comme le jeu vidéo amène à une confusion des rôles dans le champ scolaire.
L’adulte, le professeur considéré comme un joueur, pendant le temps du jeu est l’égal de l’élève.
Il y a un problème après pour revenir à la relation professeur élève.
Il y a aussi la question de ce qu’on peut faire autour du jeu, notamment l’histoire.
On peut faire une activité historique autour d’un jeu.
Il y a la possibilité de faire une activité critique autour d’un jeu à thème historique.
Autour du thème, en demandant aux élèves de se documenter.
Autour de la mécanique qui nous donne à voir la dimension économique de l’époque par exemple.
L’enseignant va devoir récupérer l’expérience acquise par le jeu pour
recentrer ce qui a été fait comme acticité ludique au cœur du programme.
[Bruno Faidutti]
Le jeu c’est extrêmement chronophage, c’est un problème. C’est un temps que l’on ne consacre plus dans le contenu.
Je souhaiterais que le jeu soit plus présent dans l’enseignement comme sujet d’étude.
On lit Madame Bovary, et on en parle, on en discute.
On jour aux colons de Catane, et puis on discute dans quelle mesure ça véhicule une certaine vision de la colonisation.
L’histoire du jeu est très intéressante, permet d’avoir des approches
sur les circulations culturelles, très intéressantes et peu étudiées, et
que l’on pourrait utiliser au Lycée.
En littérature on pourrait également faire un certain nombre de parallèles avec le jeu.
Le jeu comme thème, oui – le jeu comme outil, à condition que l’on ait
un discours critique, mais à ce moment cela devient terriblement
chronophage, le temps perdu à apprendre les règles et le temps à aborder
le discours.
Ceci dit c’est chronophage aussi de lire Madame Bovary.
[Fadila Taieb]
En tant qu’élu je reviens d’un pique nique de quartier.
On m’a demandé de remettre des aires de jeu dans un endroit où il n’y
en a pas, et de mettre un animateur pour s’occuper d’un tournoi de foot
le Dimanche – mais juste sous forme d’un jeu.
Pour moi le sport est également un jeu.
[Personne du Public]
Je suis conseiller principal d’éducation en Collège.
On a un projet où les élèves peuvent jouer en permanence, en heures de retenue, en CDI, en foyer socio-éducatif.
Le constat est qu’est-ce que l’on peut faire en accompagnant l’élève
dans sa scolarité que l’enseignant ne peut pas faire dans une classe de
30 élèves en 6eme.
On peut amener des outils par le jeu en commençant par le valoriser sur ses capacités à pouvoir se concentrer.
On lui permet de trouver sa curiosité, l’envie de connaitre quelque chose.
On a un tout projet avec des jeux de plateau, des jeux en 5 minutes mais aussi des jeux plus longs une heure, deux heures.
Au collège on a des études de 60 à 80 élèves, et en permanence le surveillant leur demande de se taire et de travailler.
Sauf qu’on ne sait pas si l’élève a du travail. On ne connait pas non plus la méthodologie de l’enseignant.
L’élève se demande pourquoi il est là, pourquoi il doit apprendre.
Le jeu est un support créatif, qui leur permet même des fois de retrouver l’envie de la scolarité.
Ce n’est pas de la compétition.
Un exemple, des élèves qui se battent à la cour de récréation.
On leur donne une heure de retenue avec des jeux coopératifs où ils sont obligés de discuter ensemble pour battre le jeu.
Ca ne passe pas par des coups, baisser le pantalon, dire je t’emmerde
parce que c’est le grand mot des élèves tout le temps dans la cour.
Ensuite, on a une discussion avec eux avec des arguments concrets par
rapport à l’exemple qu’ils ont vécu pour leur faire comprendre que vivre
ensemble c’est important.
[Gabriel Ehman]
On a tendance à parler de l’éducation Nationale, mais aussi de l’éducation à la citoyenneté.
[François Guély]
Pour un certain nombre d’apprentissages, on a besoin d’arriver à un
stade où on a automatisé une compétence ou on a mémorisé une
connaissance de façon où elle devient naturelle.
De la même manière
que l’on conduit sans réfléchir, on a des réflexes, il y a des
connaissances que l’on a besoin de mémoriser au point que l’on a plus
besoin d’y réfléchir pour y accéder.
Le calcul mental est un exemple de cela.
Pour pouvoir exploiter le calcul au collège et plus tard, il faut le mémoriser totalement pour qu’il devienne un réflexe.
L’intérêt du jeu c’est la répétition.
On rentre dans la répétition sans effort.
On joue plusieurs parties, on est concentré pendant des heures.
On répète jusqu’à ce que ce soit complètement mécanique et intégré.
Autre point essentiel : le retour immédiat d’information.
On a tout de suite le résultat par rapport à ce qu’on est en train de faire qui vous dit si c’est bon ou pas.
Dans l’apprentissage c’est essentiel. Si on doit attendre plusieurs
heures voir plus une correction, l’apprentissage n’est pas efficace du
tout parce qu’on a oublié le contexte.
L’apprentissage marche le mieux quand on a un retour d’information immédiat.
C’est ce qui se passe dans le cadre du jeu.
On a une boucle d’information immédiate qui vous informe si ce que vous
êtes en train de faire correspond ou ne correspond pas, est efficace ou
non.
[Gabriel Ehman]
En termes d’élément pour faciliter l’apprentissage, le plaisir est un élément très important.
Je voudrais vous demander, par exemple avec Timeline, on retient forcément quelque chose.
[Bruno Faidutti]
Certes on aura appris quelques dates, mais on n’aura pas appris grand chose sur la logique historique qu’il y a derrière.
On saura juste que le tire bouchon a été inventé à peu près à la même
date que le bouchon ce qui est relativement logique… mais ce n’est pas
la même date dans TimeLine
Je ne pense pas que jouer à Timeline soit équivalent à un cours d’histoire, absolument pas.
C’est amusant de jouer à Timeline, j’y joue avec les élèves à l’occasion et je m’amuse beaucoup.
Je ne pense pas que ça leur apprenne quoi que ce soit.
Ca me permet de voir ceux qui ont du bon sens ou n’en ont pas, ce qui peut être utile dans l’enseignement.
[Gabriel Ehman]
Est-ce que ça ne va pas donner l’envie à l’enfant d’en savoir plus,
avec les moyens techniques que l’on a aujourd’hui comme Wikipedia…
[Bruno Faidutti]
Mais à ce moment là le jeu c’est absolument la même chose que se
promener dans la rue, que lire un bouquin, que des tas de choses.
Qu’il y ait un apprentissage incident, des envies qui naissent en
jouant, c’est évident, mais il y en a dans toutes les activités de la
vie quotidienne.
[Gabriel Ehman]
Moi c’est mon métier, c’est l’apprentissage incident.
Je vais faire naitre à l’enfant le petit déclic, tous ces jeux, ces
astuces vont permettre que les enfants en quittant le séjour en ayant ce
déclic.
[Bruno Faidutti]
Parce que tu l’auras fait pendant les vacances.
Je ne peux pas me permettre de jouer à ça pendant toute l’année car ils n’auront pas appris grand chose pendant toute l’année.
[Phil Muller]
Les parents ne savent pas ce que ce sont les ludothèques.
On peut venir sans rien faire.
Ce que je mets en valeur c’est que le jeu fait partie du travail de l’enfant.
Il faut respecter le temps de l’enfant, par exemple le laisser terminer sa partie.
Si j’étais magicien je mettrais des ludothèques dans toutes les villes
pour permettre aux gens déjà de se rencontrer et de se connaitre.
[Bruno Faidutti]
Le jeu ça permet de se mettre autour d’une table, de ne pas se parler et de ne pas se connaitre.
C’est en partie à ça que ça sert.
[Louis Sorlat]
Le jeu ne se soucie pas d’enseigner les choses à 100%.
Le jeu permet par répétition en parallèle à un cours, de consolider les acquis par répétition.
Les synapses qui sont créées, plus elles sont activées, plus elles sont renforcées.
Le jeu permet vraiment ce processus de mémorisation beaucoup plus facile.
[Fadila Taieb]
Citoyenneté et jeu.
Le bien être de l’enfant me semble très important.
Le rythme de l’enfant – l’enfant au centre du système éducatif, ça passe forcément par le jeu.
Comment imaginer faire grandir un enfant sans utiliser le jeu?
Ca me parait complètement improbable.
C’est inhérent à l’humain, à d’autres mammifères.
C’est un système éducatif que le jeu.
Ca permet que l’enfant se sente bien, d’intégrer les règles, d’intégrer
peut-être une vie citoyenne ou il peut être plus éclairé, participatif.
[Personne du Public]
Je voudrais parler du jeu que j’ai créé qui n’est pas encore édité.
Il essaie d’allier le côté pédagogique et le côté amusement.
Je pense que Monsieur Faidutti a peur de ne pas s’amuser avec les jeux pédagogiques.
[Bruno Faidutti]
Je pense que mes élèves s’amusent plus quand je fais cours que quand on joue.
[Personne du Public]
Mon idée à la base c’est de regrouper ces deux univers.
Le moment où l’enfant s’évade dans un jeu et ne pense plus à l’école et en même temps d’inculquer des choses importantes.
Les enfants apprennent beaucoup mieux quand c’est agréable, amusant.